Comment écrire des dialogues réussis dans un roman ?
- Christine

- 7 sept. 2025
- 10 min de lecture
Dernière mise à jour : 10 sept. 2025
Que vous écriviez un roman réaliste, historique, policier, autobiographique, de fantasy ou de science-fiction, l’écriture de dialogues est un élément incontournable de votre travail.
Qu’est-ce qu’un bon dialogue ? Quelles sont les règles à connaître et à respecter pour la mise en page des dialogues ? Comment écrire des dialogues percutants pour votre roman ? Je vous livre mes conseils et techniques dans ce billet de blog !

Définition
Un dialogue se compose des paroles échangées entre plusieurs personnages. Cela signifie qu’un dialogue implique au moins deux personnages.
Si un seul personnage prend la parole, il s’agira alors d’un monologue — intérieur, le plus souvent, car il est extrêmement rare qu’un personnage parle tout seul à haute voix.
Rôle et fonction des dialogues
Les dialogues ne sont pas décoratifs ; ils remplissent plusieurs fonctions importantes :
Les dialogues font partie intégrante du récit.
Un texte de fiction en prose, qu’il s’agisse d’un roman ou d’une nouvelle, est composé de narration, de description, de dialogues et de monologues. En composant chaque chapitre ou chaque scène de votre roman avec ces quatre éléments, vous vous assurez d’obtenir un récit équilibré. A l’inverse, un chapitre qui serait uniquement constitué d’une longue description, par exemple, risquerait d’être monotone à la lecture. Le lecteur a besoin de variété.
Les dialogues rythment le texte.
Le fait d’insérer un dialogue au milieu ou à la suite d’une description permet d’accélérer le tempo du récit. A l’inverse, insérer un dialogue au milieu ou à la suite d'une action permet de ralentir la cadence. Ces variations de rythme contribuent à la qualité de l’écriture et au plaisir de la lecture.
Les dialogues caractérisent les personnages.
En donnant la parole à vos personnages, vous permettez au lecteur d’en savoir plus sur eux. Leurs voix, leurs tics de langage, leurs débits de parole, leurs registres de langue, leur vocabulaire, peuvent informer sur leur niveau social, leurs origines géographiques, mais aussi leurs tempéraments. Exemples : un personnage timide ne finit pas ses phrases ; un personnage intrusif coupe la parole aux autres ; un personnage égocentrique se lance dans de longues répliques ; un personnage nerveux parle sans reprendre son souffle, etc.
Les dialogues font avancer l’intrigue en donnant de nouvelles informations.
Plutôt que de résumer ces informations dans la narration ou dans un monologue, le fait de les livrer dans un dialogue peut parfois être plus efficace et dynamique. Par exemple, plutôt que d’avoir une prise de conscience soudaine (souvent peu crédible à la lecture), votre personnage pourrait comprendre une chose importante lors d’un échange avec un autre personnage.
Lorsque vous écrivez ou retravaillez les dialogues de votre roman, gardez en tête que ceux-ci doivent remplir au moins l'une des fonctions citées ci-dessus.
Comment écrire des dialogues réussis dans un roman
La mise en page des dialogues
En matière de présentation des dialogues, il existe deux écoles :
L’école traditionnelle marque le début et la fin d'un dialogue par des guillemets, et utilise les tirets pour indiquer l’alternance de répliques.
L’école moderne utilise uniquement les tirets (cadratins ou semi-cadratins) pour marquer chaque nouvelle réplique de dialogue.
Les deux écoles sont toujours en vigueur, quoique la présentation moderne soit la plus répandue de nos jours. Choisissez celle qui vous convient le mieux, mais sachez que c'est l'éditeur qui a le dernier mot sur la présentation à adopter.
✅ Un exemple : extrait de Chroniques martiennes de Ray Bradbury (1950) :
Ecole traditionnelle :
« Tu as encore rêvé, dit-il. Tu as parlé tout haut et ça m’a empêché de dormir. Je crois vraiment que tu devrais voir un docteur.
— Ça ira.
— Tu n’as pas arrêté de bavarder en dormant.
— Vraiment ? » Elle entreprit de se redresser.
Le petit jour était froid dans la pièce. Toujours allongée, Ylla se sentait envahie par une lumière grisâtre.
« A quoi rêvais-tu ? »
Elle dut réfléchir un instant pour se souvenir. « A ce vaisseau. Il descendait encore une fois du ciel, se posait, et l’homme de haute taille en sortait, me parlait, plaisantait avec moi. C’était très agréable. »
Le visage de Mr. K demeura impassible.
Ecole moderne :
— Tu as encore rêvé, dit-il. Tu as parlé tout haut et ça m’a empêché de dormir. Je crois vraiment que tu devrais voir un docteur.
— Ça ira.
— Tu n’as pas arrêté de bavarder en dormant.
— Vraiment ? Elle entreprit de se redresser.
Le petit jour était froid dans la pièce. Toujours allongée, Ylla se sentait envahie par une lumière grisâtre.
— A quoi rêvais-tu ?
Elle dut réfléchir un instant pour se souvenir.
— A ce vaisseau. Il descendait encore une fois du ciel, se posait, et l’homme de haute taille en sortait, me parlait, plaisantait avec moi. C’était très agréable.
Le visage de Mr. K demeura impassible.

Une typographie sobre
Les caractères en capitale sont à bannir.
N’écrivez aucune réplique ni aucun mot en majuscules pour retranscrire les cris d’un personnage. Cette pratique n’est acceptée que dans la bande dessinée. La colère ou la frustration doit se ressentir dans le choix des mots et non dans leur présentation.
N’abusez pas des points d'exclamation et de suspension.
Ceux-ci doivent rester exceptionnels dans un récit en prose. Remplacez-les par des virgules ou des points simples, et retravaillez plutôt la phrase elle-même pour retranscrire l’étonnement ou l’hésitation ou l’exclamation que vous voulez transmettre.
La concision
Les dialogues ne doivent pas être trop longs, tant dans la place qu’ils occupent au sein d’un chapitre, que dans leurs répliques. Au-delà d’une page, un dialogue est considéré comme long. Au-delà de deux lignes, une réplique est considérée comme longue.
Si l’un de vos dialogues nécessite une longueur inhabituelle (un interrogatoire, une discussion importante, un repas de famille incluant de nombreux personnages), envisagez d’entrecouper le dialogue de phrases de narration ou de description. Cela vous permettra d’introduire des variations de rythme et vous évitera de tomber dans une forme de monotonie.
Si vos répliques de dialogues sont longues, retravaillez-les pour les raccourcir. Elaguez le superflu, ne gardez que les mots strictement nécessaires. Oubliez les répliques de dialogues « trop écrites ». De longues répliques de dialogue sont acceptables dans certains cas exceptionnels, par exemple lorsqu’un personnage de nature loquace ou égocentrique prend la parole, ou lorsque l’état émotionnel d’un personnage se traduit par un flot de paroles inhabituel. Mais en règle générale, un bon dialogue se compose de répliques concises, incisives, percutantes.
✅ Un exemple : extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert (1856)
— Quand minuit sonnera, disait-elle, tu penseras à moi !
Et, s’il avouait n’y avoir point songé, c’étaient des reproches en abondance, et qui se terminaient toujours par l’éternel mot :
— M’aimes-tu ?
— Mais oui, je t’aime, répondait-il.
— Beaucoup ?
— Certainement.
— Tu n’en as pas aimé d’autres, hein ?
— Crois-tu m’avoir pris vierge ? exclamait-il en riant.
Emma pleurait, et il s’efforçait de la consoler, enjolivant de calembours ses protestations.
— Oh, c’est que je t’aime ! reprenait-elle, je t’aime à ne pouvoir me passer de toi, sais-tu bien ? J’ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l’amour me déchirent. Je me demande : « Où est-il ? Peut-être il parle à d’autres femmes ? Elles lui sourient, il s’approche… » Oh non, n’est-ce pas, aucune ne te plaît ? Il y en a de plus belles ; mais, moi, je sais mieux aimer. Je suis ta servante et ta concubine. Tu es mon roi, mon idole. Tu es bon, tu es beau, tu es intelligent, tu es fort !
Dans cet extrait, toutes les répliques de dialogues sont courtes, à l’exception de la dernière, une réplique d’Emma Bovary qui tourne au monologue, montrant le désespoir grandissant de l’héroïne et, par contraste, le détachement silencieux de son amant Rodolphe.

L’utilisation des incises
Définition :
Les incises sont ces portions de phrase qui indiquent au lecteur quel personnage parle : « dit-il », « répondit-elle », « demanda Marie », par exemple.
Suffisamment, mais pas trop :
La règle du bon usage des incises est « suffisamment, mais pas trop ». Mettez une incise lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque le lecteur a besoin d’une indication pour savoir qui parle. En revanche, si le locuteur est évident, c’est-à-dire si l’on sait quel personnage a prononcé la réplique sans qu’on nous le dise, alors l’incise n’est pas nécessaire.
Dans un dialogue avec deux personnages :
La première réplique de dialogue comportera généralement une incise, pour indiquer quel personnage a pris la parole en premier. La réplique suivante sera logiquement la réponse de l’autre personnage, et n’a donc pas besoin d’incise. La troisième réplique n’aura pas besoin d’incise non plus, puisque les deux personnages parlent à tour de rôle.
✅ C’est exactement ce que fait Bradbury dans notre précédent exemple :
— Tu as encore rêvé, dit-il (incise indiquant que le personnage masculin est le premier à prendre la parole). Tu as parlé tout haut et ça m’a empêché de dormir. Je crois vraiment que tu devrais voir un docteur.
— Ça ira. (Absence d’incise car elle est inutile : par déduction, on sait que c’est le personnage féminin, le seul autre présent dans la scène, qui répond)
— Tu n’as pas arrêté de bavarder en dormant. (Le personnage masculin réplique)
— Vraiment ? Elle entreprit de se redresser. (C’est au tour du personnage féminin de répliquer)
Dans un dialogue avec plus de deux personnages :
Les incises seront davantage nécessaires pour aider le lecteur à se repérer dans les différents échanges. Mais pour éviter de les multiplier, il est également possible de s’appuyer sur la narration, de décrire les expressions, les attitudes ou les mouvements des personnages.
✅ Un exemple : extrait de Des Souris et des hommes de John Steinbeck (1937).
Curley dévisagea froidement George et Lennie. Son regard était à la fois calculateur et belliqueux. Lennie commença à se tortiller et à se balancer d’un pied sur l’autre, cette œillade le rendait nerveux. Curley s’avança prudemment tout près de lui. « C’est vous les nouveaux que l’vieux attendait ?
— On vient d’arriver, dit George.
— Laisse parler l’malabar. »
Lennie se tordait dans l’embarras le plus profond.
George dit : « Suppose qu’il veuille pas parler ? »
Curley se redressa soudain, sec comme un coup de fouet. « Bon sang, il a intérêt à répondre quand on lui parle. C’est quoi l’embrouille ?
— On fait la route ensemble, dit George froidement.
— Ah ouais ? Alors c’est comme ça ? »
George était tendu et immobile. « Ouais, c’est comme ça. »
Lennie regardait George d’un air désespéré dans l’attente d’instructions.
« Et tu veux pas laisser le grand type parler, c’est ça ?
— Il peut parler s’il a quelque chose à vous dire. »
George fit un petit signe de la tête à Lennie. « On vient juste d’arriver », dit Lennie d’une petite voix.
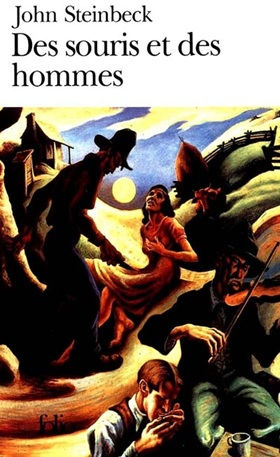
Utiliser des incises neutres :
Une erreur fréquente consiste à penser que pour éviter les répétitions, il convient de varier les incises en faisant appel à des verbes tels que déclarer, affirmer, s’écrier, hurler, gémir, rétorquer, répliquer, interroger, etc. Or, le rôle des incises est d’indiquer au lecteur qui parle, puis de se faire oublier. En effet, l’attention du lecteur doit se porter sur les paroles du personnage, et non sur l’incise. Pour le dire autrement, travaillez et peaufinez vos répliques de dialogues, mais faites simple quand il s’agit des incises. Utilisez donc de préférence les incises neutres, c’est-à-dire celles qui emploient l’un des quatre verbes suivants : dire, faire, demander, répondre.
✅ Un exemple :
Plutôt que d’écrire :
— Je vais te tuer, hurla-t-il hargneusement.
Ecrivez plutôt :
— Je vais te tuer, dit-il.
Ou encore :
— Je vais te tuer, dit-il les yeux exorbités.
Des voix distinctes :
Chaque personnage doit avoir sa propre manière de parler. Un écueil fréquent chez les auteurs débutants consiste à donner aux personnages une voix uniforme (généralement une voix neutre, ou alors celle de l’auteur). Celle-ci ne permet de retranscrire ni l’identité ni le tempérament du personnage.
Or, comme dit plus haut, les dialogues doivent caractériser les personnages à travers leur façon de s’exprimer. Pensez donc à varier le vocabulaire, le registre de langue, le champ lexical, le débit de parole, afin d’attribuer à chaque personnage une voix propre. Un dialogue réussi, c’est un dialogue dans lequel on devrait pouvoir reconnaître les voix des différents personnages sans avoir recours aux incises.
Pour travailler les voix, vous devez acquérir une connaissance fine et approfondie de chacun de vos personnages. Si vous ne savez pas qui ils sont en tant qu’individus, il vous sera difficile de les entendre parler, d’imaginer leurs paroles, et donc de retranscrire leurs mots dans des répliques de dialogues spécifiques.
✅ Un exemple : extrait de L’Assommoir d’Emile Zola (1877).
— Monsieur, demanda-t-elle, c’est ici, n’est-ce pas, que travaille un enfant du nom d’Étienne ? C’est mon garçon.
— Étienne, Étienne, répétait l’ouvrier qui se dandinait, la voix enrouée ; Étienne, non, connais pas.
La bouche ouverte, il exhalait cette odeur d’alcool des vieux tonneaux d’eau-de-vie, dont on a enlevé la bonde. Et, comme cette rencontre d’une femme dans ce coin d’ombre commençait à le rendre goguenard, Gervaise recula, en murmurant :
— C’est bien ici pourtant que monsieur Goujet travaille ?
— Ah, Goujet, oui, dit l’ouvrier. Connu Goujet. Si c’est pour Goujet que vous venez, allez au fond.
Et, se tournant, il cria de sa voix qui sonnait le cuivre fêlé :
— Dis donc, la Gueule-d’Or, voilà une dame pour toi !

Une technique avancée pour maîtriser l’art des dialogues : le sous-texte
Un réflexe courant est d’écrire des dialogues linéaires : le personnage A pose une question au personnage B, et le personnage B répond à la question. Il y a une certaine logique dans cette pratique, qui reflète un besoin de cohérence ou de politesse.
✅ Un exemple de dialogue linéaire :
— Qui peut m’aider à organiser les 70 ans de maman ?
— Je ne pourrai pas. Mon médecin m’a conseillé du repos.
— Désolée, je suis très occupé la semaine prochaine.
Mais dans la fiction, les dialogues non-linéaires, c’est-à-dire ceux dans lesquels les personnages répondent de façon indirecte ou inattendue à une question, sont plus intéressants que les dialogues linéaires.
✅ Un exemple de dialogue non-linéaire :
— Qui peut m’aider à organiser les 70 ans de maman ?
— J’ai vu mon médecin la semaine dernière. Ménard, tu le connais aussi, je crois ? Il a pris un sacré coup de vieux. « Si vous ne voulez pas finir comme moi, il faut vous ménager », qu’il m’a dit, « pas d’effort inutile. »
— Roger a réservé aux Baléares pour nos dix ans de mariage. Je suis pas censée le savoir, c’est une surprise. On part la semaine prochaine, j’ai trop hâte, mais je sais pas quand est-ce qu’on rentre.
Les réponses indirectes, ou le fait de réagir à une question en changeant de sujet, crée ce que l’on appelle le sous-texte : des sous-entendus, des pensées non exprimées par le locuteur, des émotions voire même des informations cachées sur les personnages. Le sous-texte, c’est ce qui se trouve « sous le texte », ce qui est révélé sans être dit, ce qui se cache derrière les mots. Introduire du sous-texte dans ses dialogues permet de rendre ceux-ci plus riches, plus lourds de sens, et de créer ainsi de la tension narrative.
Conclusion
Vous venez d'avoir un aperçu des techniques principales à connaître pour réussir l'écriture des dialogues dans un roman. Mais la maîtrise de cet aspect ne s'arrête pas là. Pour en savoir plus et progresser dans l'écriture de dialogues, découvrez nos formations et stages d'écriture :



Commentaires